Haïti : violence et politique
http://www.alterpresse.org/
vendredi 12 janvier 2007
Par Laënnec Hurbon [1]
Soumis à AlterPresse le 8 janvier 2007
Une chaîne de signes nous met devant la dure évidence d’un pouvoir qui sort de ses rails et reconnaît son impuissance à correspondre à sa visée première et essentielle, celle d’assurer la sûreté (protection que l’État accorde aux citoyens contre l’arbitraire et pour la conservation de ses biens et de ses droits) et la sécurité (de la vie) de chacun. Si l’État dispose, selon la philosophie politique traditionnelle, du monopole de la violence légitime, l’Exécutif haïtien y renonce en partie à travers la décision de négocier avec des bandits.
Au départ, il est bon de rappeler la toile de fond actuelle sur laquelle se détache cette négociation. Peu après les élections du 7 février dernier, des kidnappeurs sont comme par enchantement libérés. La plainte déposée aux États-Unis contre Aristide est levée. Des fonctionnaires suspects de corruption sont remis à leur poste. Dans une commission gouvernementale on introduit un porte-parole autoproclamé de l’opération Bagdad. Une opération qui a endeuillé tant de familles par le vol, le viol, le kidnapping et la destruction d’un marché où périrent une douzaine de commerçants et où des dizaines d’autres ont vu périr dans les flammes toutes leurs marchandises.
Enfin, un concept dit d’apaisement social prétend imposer sur la seule base des inégalités sociales une interprétation de la criminalité galopante et de la barbarie qui l’accompagne. Argument auquel fait chorus la MINUSTAH pour justifier son parti pris et sa passivité. Mais on n’explique pas pourquoi les victimes des bandits sont de toutes les catégories sociales et pourquoi en grande majorité ce sont les pauvres. La barbarie qui consiste à violer des enfants, à les assassiner, puis à enlever des cars remplis d’écoliers relève de l’incroyable pour la population, toutes classes sociales confondues. En sorte que chacun, dans la capitale notamment, finit par vivre sous la menace de kidnapping, de viol et d’assassinat, donc dans la plus grande insécurité.
L’État au service d’un groupe
Au-delà de l’amalgame entre une institution étatique à forte épaisseur historique et un groupe de bandits qui ne représentent que les milieux de la criminalité, il importe de considérer la conception de l’État et du politique que présuppose le principe d’une négociation avec des bandits.
En effet, dans cette perspective le pouvoir n’a plus pour tâche de défendre ce qu’on appelle l’universel, il déchoit dans la défense des intérêts particuliers ; il ne fonctionne plus pour l’ensemble des citoyens sans exception, car il semble prendre sur lui d’assurer d’abord la protection des bandits. Mais ne nous empressons pas d’imputer au pouvoir une mauvaise foi, il doit probablement avoir une conception bien particulière des bandits, qui lui permet de comprendre et de s’expliquer le regain actuel de criminalité.
Les bandits criminels seraient-ils les pauvres qui décident maintenant de prendre leur revanche ? Je pourrais donc, comme pauvre, entrer par effraction dans n’importe quelle maison, accaparer l’argent, les bijoux, les voitures, les femmes et les enfants ? Cela signifierait que le bandit aurait tous les droits ; dans l’acte criminel, il est en effet sa propre loi comme un petit roi tout-puissant, qui n’a plus aucune limite, aucun cran d’arrêt à ses désirs, c’est ce qui explique qu’il peut aller jusqu’à des actes de barbarie.
Une négation de la démocratie
En soustrayant le bandit à la loi, l’État ne fait que pervertir le principe de la lutte de classes dont il dévie totalement le sens vers une pratique populiste. On accorderait donc aux bandits la possibilité de représenter les pauvres, et même de disposer du droit de la majorité. Le pouvoir en ferait sa base principale et leur serait redevable. Or c’est précisément par là que le pouvoir adopte une position antidémocratique, car il cesse de se laisser guider par une politique du bien commun. C’est en effet dans la recherche du bien commun que le pouvoir instaure un va-et-vient de discussions et de décisions avec tous les groupes sociaux constituant la nation et qu’il pourra déterminer comment soutenir avec équité les revendications de ceux qui sont dans la pénurie ou qui sont exploités. Mais avec la dérive populiste dans la violence et la soumission aux diktats des délinquants qui se mettent en dehors de la loi, l’État prendra nécessairement la pente de la corruption et aboutira peu à peu à contribuer lui-même à la destruction du lien social et à la désorganisation de la vie économique, par quoi le pays connaîtra davantage de pauvreté.
S’il n’y a plus d’universalité de la loi, c’est-à-dire s’il y a éclipse de la loi, suspension de la loi qui peut frapper celui qui la viole, le pays plongera dans les ténèbres de la barbarie, ce qui correspondrait fort bien à l’anathème d’Aristide : « il fera nuit la nuit comme le jour, si la démocratie n’existe pas » (traduction : « si moi Aristide je ne fais pas mes cinq ans, ou si moi, je ne reviens pas en Haïti » ou encore « la démocratie c’est moi, Aristide ». En soustrayant le bandit à la loi, l’Exécutif parvient à se mettre à la place du système judiciaire. À ce moment, et l’État, et le politique, et l’ordre symbolique qui permettent à la société de se tenir debout, dans la mesure où ils constituent son épine dorsale, viennent à vaciller, et nous tombons facilement sous le paradigme du Rwanda : le bandit a les mains libres pour tuer et kidnapper, voler et violer, car l’État et le pouvoir se sabordent et provoquent leur propre naufrage.
Le fantasme du pouvoir absolu
C’est la Loi qui fait que chaque Haïtien peut reconnaître en un autre individu un être humain et qui maintient constamment la possibilité d’un avenir pour la société comme société humaine. Logiquement, il est impossible que la négociation avec les bandits puisse « donner de bons résultats », elle se retournera même tôt ou tard contre les tenants actuels de l’Exécutif, à moins que ces résultats se confondent avec l’absolu du pouvoir politique établi qui serait le pouvoir absolu.
L’acte du kidnapping ne serait-il pas avant tout le retour du fantasme du maître qui voit dans l’esclave le bien meuble qu’il peut échanger contre de l’argent ? N’est-ce pas là un processus de zombification : le fantasme d’un pouvoir absolu ? Que Aristide se déclare le kidnappé des grandes puissances, et qu’il ait des partisans pour reprendre ses dires, n’est-ce pas un stratagème pour ouvrir le chemin à la justification du crime du kidnapping comme punition pour toute la société par la réduction de chaque Haïtien à l’état d’esclave° ? Bien entendu, Aristide serait à lui seul tout le pays. Comme un tyran, ou un dictateur romain. Comme Néron. Comme Caligula.
La force de l’État : la force de la loi
Est-ce qu’on ne peut pas dire par exemple que le gouvernement est trop faible et qu’il hérite d’une situation dans laquelle il ne disposerait pas tout à fait des forces nécessaires pour combattre le banditisme ? Le rapport de forces est obligatoirement en faveur de l’État, car il a pour lui la loi, une force plus puissante que les armes à feu, il peut alors sur cette base mobiliser la nation et entrer en campagne pour mettre en défaite le banditisme par des arguments fondés sur la raison et la morale. Mais ce n’est pas suffisant, encore faut-il qu’il cherche les moyens adéquats de répression prévus dans la Loi pour assurer la sûreté et la sécurité des vies et des biens. On est pouvoir exécutif parce qu’on est en mesure de chercher et de trouver ces moyens qui ne seront jamais et qui ne pourront jamais être des appuis offerts à des bandits. Sous la condamnation unanime (de nombreux citoyens, de diverses associations, de personnalités proches des droits humains, du Parlement, ...) de la négociation avec des bandits, le pouvoir déclare chercher désormais à les traquer. Mais la vigilance doit plus que jamais s’imposer.
Seul le retour au principe de la sanction et de la peine pour les actes de banditisme, tel que la Loi le prévoit dans son universalité- et cette perspective n’a rien d’abstrait ni d’idéaliste- peut manifester le respect pour la souffrance des victimes (qui appartient à toute la société) et ouvrir la voie à la sûreté et à la sécurité pour tous. Ce sont là les conditions nécessaires pour que la pauvreté recule, car alors les investissements seront possibles et le développement ne sera pas un slogan et un simple vœu ; la lutte contre les inégalités sociales se fera plus vraie et plus efficace. Choisir l’axe de la légalité et de la justice, c’est se mettre en condition d’ouvrir le chemin du développement et de s’assurer du soutien de toute la société haïtienne, comme de l’ensemble de la communauté internationale.
[1] Sociologue. Directeur de recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique-Paris). Professeur à l’Université Quisqueya
http://www.alterpresse.org/
vendredi 12 janvier 2007
Par Laënnec Hurbon [1]
Soumis à AlterPresse le 8 janvier 2007
Une chaîne de signes nous met devant la dure évidence d’un pouvoir qui sort de ses rails et reconnaît son impuissance à correspondre à sa visée première et essentielle, celle d’assurer la sûreté (protection que l’État accorde aux citoyens contre l’arbitraire et pour la conservation de ses biens et de ses droits) et la sécurité (de la vie) de chacun. Si l’État dispose, selon la philosophie politique traditionnelle, du monopole de la violence légitime, l’Exécutif haïtien y renonce en partie à travers la décision de négocier avec des bandits.
Au départ, il est bon de rappeler la toile de fond actuelle sur laquelle se détache cette négociation. Peu après les élections du 7 février dernier, des kidnappeurs sont comme par enchantement libérés. La plainte déposée aux États-Unis contre Aristide est levée. Des fonctionnaires suspects de corruption sont remis à leur poste. Dans une commission gouvernementale on introduit un porte-parole autoproclamé de l’opération Bagdad. Une opération qui a endeuillé tant de familles par le vol, le viol, le kidnapping et la destruction d’un marché où périrent une douzaine de commerçants et où des dizaines d’autres ont vu périr dans les flammes toutes leurs marchandises.
Enfin, un concept dit d’apaisement social prétend imposer sur la seule base des inégalités sociales une interprétation de la criminalité galopante et de la barbarie qui l’accompagne. Argument auquel fait chorus la MINUSTAH pour justifier son parti pris et sa passivité. Mais on n’explique pas pourquoi les victimes des bandits sont de toutes les catégories sociales et pourquoi en grande majorité ce sont les pauvres. La barbarie qui consiste à violer des enfants, à les assassiner, puis à enlever des cars remplis d’écoliers relève de l’incroyable pour la population, toutes classes sociales confondues. En sorte que chacun, dans la capitale notamment, finit par vivre sous la menace de kidnapping, de viol et d’assassinat, donc dans la plus grande insécurité.
L’État au service d’un groupe
Au-delà de l’amalgame entre une institution étatique à forte épaisseur historique et un groupe de bandits qui ne représentent que les milieux de la criminalité, il importe de considérer la conception de l’État et du politique que présuppose le principe d’une négociation avec des bandits.
En effet, dans cette perspective le pouvoir n’a plus pour tâche de défendre ce qu’on appelle l’universel, il déchoit dans la défense des intérêts particuliers ; il ne fonctionne plus pour l’ensemble des citoyens sans exception, car il semble prendre sur lui d’assurer d’abord la protection des bandits. Mais ne nous empressons pas d’imputer au pouvoir une mauvaise foi, il doit probablement avoir une conception bien particulière des bandits, qui lui permet de comprendre et de s’expliquer le regain actuel de criminalité.
Les bandits criminels seraient-ils les pauvres qui décident maintenant de prendre leur revanche ? Je pourrais donc, comme pauvre, entrer par effraction dans n’importe quelle maison, accaparer l’argent, les bijoux, les voitures, les femmes et les enfants ? Cela signifierait que le bandit aurait tous les droits ; dans l’acte criminel, il est en effet sa propre loi comme un petit roi tout-puissant, qui n’a plus aucune limite, aucun cran d’arrêt à ses désirs, c’est ce qui explique qu’il peut aller jusqu’à des actes de barbarie.
Une négation de la démocratie
En soustrayant le bandit à la loi, l’État ne fait que pervertir le principe de la lutte de classes dont il dévie totalement le sens vers une pratique populiste. On accorderait donc aux bandits la possibilité de représenter les pauvres, et même de disposer du droit de la majorité. Le pouvoir en ferait sa base principale et leur serait redevable. Or c’est précisément par là que le pouvoir adopte une position antidémocratique, car il cesse de se laisser guider par une politique du bien commun. C’est en effet dans la recherche du bien commun que le pouvoir instaure un va-et-vient de discussions et de décisions avec tous les groupes sociaux constituant la nation et qu’il pourra déterminer comment soutenir avec équité les revendications de ceux qui sont dans la pénurie ou qui sont exploités. Mais avec la dérive populiste dans la violence et la soumission aux diktats des délinquants qui se mettent en dehors de la loi, l’État prendra nécessairement la pente de la corruption et aboutira peu à peu à contribuer lui-même à la destruction du lien social et à la désorganisation de la vie économique, par quoi le pays connaîtra davantage de pauvreté.
S’il n’y a plus d’universalité de la loi, c’est-à-dire s’il y a éclipse de la loi, suspension de la loi qui peut frapper celui qui la viole, le pays plongera dans les ténèbres de la barbarie, ce qui correspondrait fort bien à l’anathème d’Aristide : « il fera nuit la nuit comme le jour, si la démocratie n’existe pas » (traduction : « si moi Aristide je ne fais pas mes cinq ans, ou si moi, je ne reviens pas en Haïti » ou encore « la démocratie c’est moi, Aristide ». En soustrayant le bandit à la loi, l’Exécutif parvient à se mettre à la place du système judiciaire. À ce moment, et l’État, et le politique, et l’ordre symbolique qui permettent à la société de se tenir debout, dans la mesure où ils constituent son épine dorsale, viennent à vaciller, et nous tombons facilement sous le paradigme du Rwanda : le bandit a les mains libres pour tuer et kidnapper, voler et violer, car l’État et le pouvoir se sabordent et provoquent leur propre naufrage.
Le fantasme du pouvoir absolu
C’est la Loi qui fait que chaque Haïtien peut reconnaître en un autre individu un être humain et qui maintient constamment la possibilité d’un avenir pour la société comme société humaine. Logiquement, il est impossible que la négociation avec les bandits puisse « donner de bons résultats », elle se retournera même tôt ou tard contre les tenants actuels de l’Exécutif, à moins que ces résultats se confondent avec l’absolu du pouvoir politique établi qui serait le pouvoir absolu.
L’acte du kidnapping ne serait-il pas avant tout le retour du fantasme du maître qui voit dans l’esclave le bien meuble qu’il peut échanger contre de l’argent ? N’est-ce pas là un processus de zombification : le fantasme d’un pouvoir absolu ? Que Aristide se déclare le kidnappé des grandes puissances, et qu’il ait des partisans pour reprendre ses dires, n’est-ce pas un stratagème pour ouvrir le chemin à la justification du crime du kidnapping comme punition pour toute la société par la réduction de chaque Haïtien à l’état d’esclave° ? Bien entendu, Aristide serait à lui seul tout le pays. Comme un tyran, ou un dictateur romain. Comme Néron. Comme Caligula.
La force de l’État : la force de la loi
Est-ce qu’on ne peut pas dire par exemple que le gouvernement est trop faible et qu’il hérite d’une situation dans laquelle il ne disposerait pas tout à fait des forces nécessaires pour combattre le banditisme ? Le rapport de forces est obligatoirement en faveur de l’État, car il a pour lui la loi, une force plus puissante que les armes à feu, il peut alors sur cette base mobiliser la nation et entrer en campagne pour mettre en défaite le banditisme par des arguments fondés sur la raison et la morale. Mais ce n’est pas suffisant, encore faut-il qu’il cherche les moyens adéquats de répression prévus dans la Loi pour assurer la sûreté et la sécurité des vies et des biens. On est pouvoir exécutif parce qu’on est en mesure de chercher et de trouver ces moyens qui ne seront jamais et qui ne pourront jamais être des appuis offerts à des bandits. Sous la condamnation unanime (de nombreux citoyens, de diverses associations, de personnalités proches des droits humains, du Parlement, ...) de la négociation avec des bandits, le pouvoir déclare chercher désormais à les traquer. Mais la vigilance doit plus que jamais s’imposer.
Seul le retour au principe de la sanction et de la peine pour les actes de banditisme, tel que la Loi le prévoit dans son universalité- et cette perspective n’a rien d’abstrait ni d’idéaliste- peut manifester le respect pour la souffrance des victimes (qui appartient à toute la société) et ouvrir la voie à la sûreté et à la sécurité pour tous. Ce sont là les conditions nécessaires pour que la pauvreté recule, car alors les investissements seront possibles et le développement ne sera pas un slogan et un simple vœu ; la lutte contre les inégalités sociales se fera plus vraie et plus efficace. Choisir l’axe de la légalité et de la justice, c’est se mettre en condition d’ouvrir le chemin du développement et de s’assurer du soutien de toute la société haïtienne, comme de l’ensemble de la communauté internationale.
[1] Sociologue. Directeur de recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique-Paris). Professeur à l’Université Quisqueya

















































































































-3.jpg)


.jpg)





.jpg)











.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)














































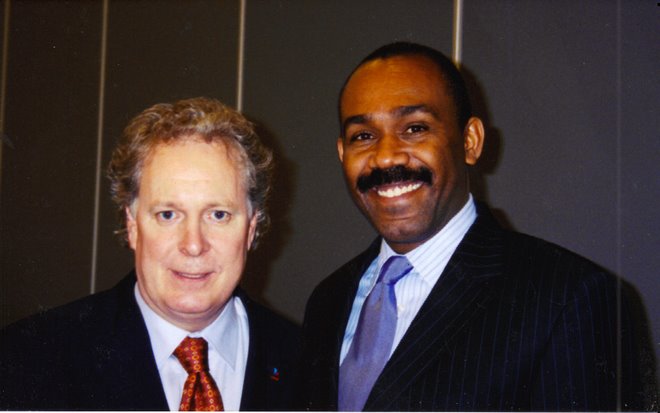








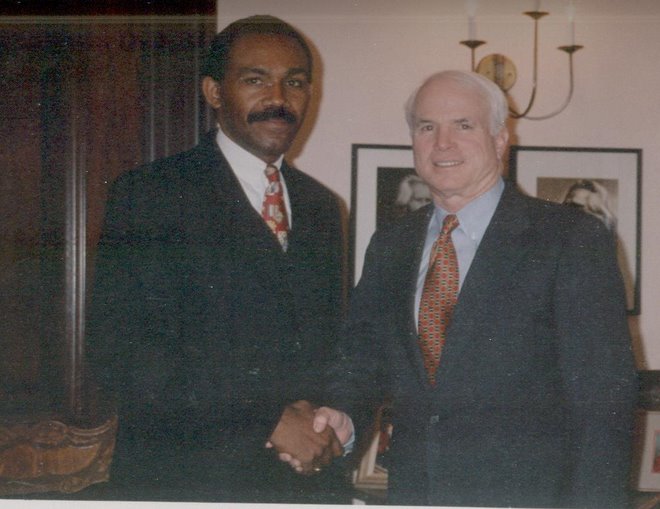







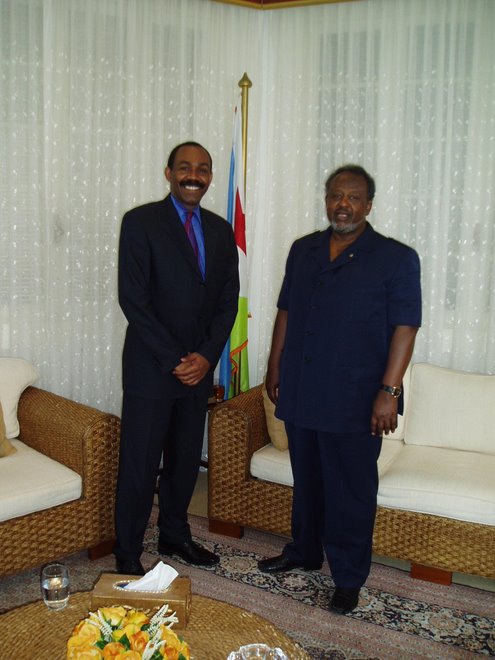



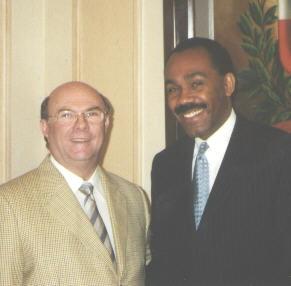
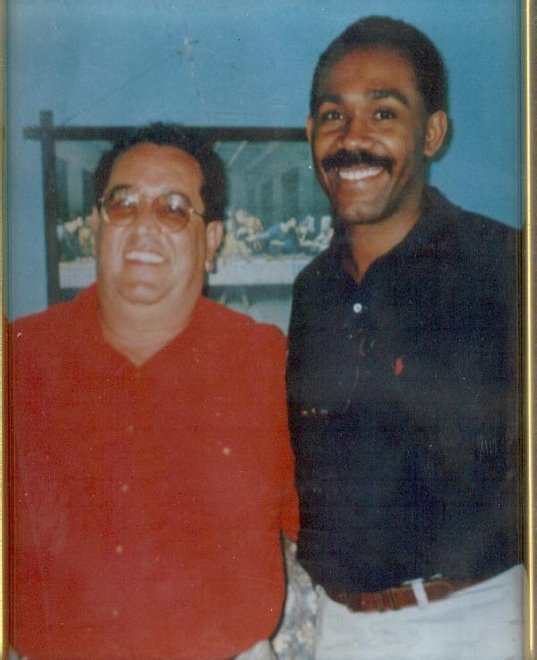

No comments:
Post a Comment